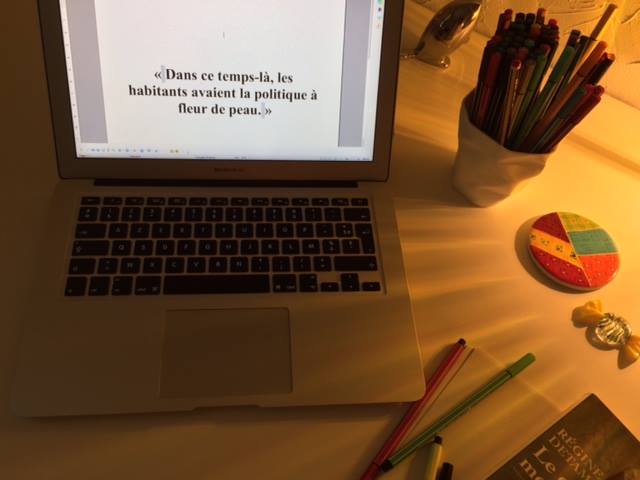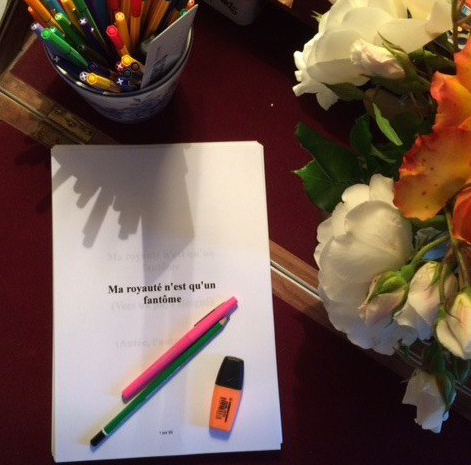L’écriture de Paul Lynch ? Un puits de lumière… j’allais dire, un puits de Grace, où le lecteur vient puiser une énergie poétique, où les personnages se meuvent « dans la lumière de [leur ] propre rage», dans les rêves et les fantasmes de Grace.
Le lecteur vient puiser une énergie poétique, où les personnages se meuvent « dans la lumière de [leur ] propre rage», dans les rêves et les fantasmes de Grace.
Et si toucher la terreur et le Mal absolu, de « tout son vouloir se réduire (…) à une aspiration aux ténèbres des profondeurs, [s’y laisser] sombrer jusqu’aux tréfonds » par l’écriture était une manière de faire surgir la lumière ?
Ce n’est sans doute pas un hasard si l’auteur Paul Lynch prénomme son personnage principal Grace. Pourquoi raconter le territoire de l’enfance, ce socle de graines d’émotions, en explorant le Mal (et le Mâle) ? Pourquoi prendre le parti de creuser au plus profond de la Grande famine qui ravage la terre d’Irlande ?
1845. La veille de Samhain, une des fêtes qui annonce novembre, rituel de passage entre le monde des humains et l’Autre monde, la résidence des Dieux. Comment une mère peut-elle demander à sa fille de partir pour trouver du travail et survivre dans une terre qui se meurt ? Grace qui a droit à un véritable festin pour prendre des forces, Grace qui se prépare à traverser le temps et l’espace. Car Grace, malgré (et peut-être grâce à) la volonté maternelle, s’engage dans une « odyssée vers la lumière».
Du feu, des miroirs, un travestissement, une fuite organisée par la Mère nourricière en personne, il n’en faut pas davantage pour que le lecteur comprenne que rester pour Grace signifierait vivre l’Enfer, que partir le sera tout autant.
Oui, mais alors, pour aller où et à quoi bon ?
L’écriture de Paul Lynch ? Un puits de lumière… j’allais dire, un puits de Grace, où le lecteur vient puiser une énergie poétique, où les personnages se meuvent « dans la lumière de [leur ] propre rage», dans les rêves et les fantasmes de Grace. L’espoir croupi dans l’ombre du récit saturé de menaces et de violence, une violence qui rôde et accomplit son travail comme « la roue d’un moulin tournant à toute vitesse. » Mais là où il y a encore possibilité de rêver autant que de fantasmer le morbide, quand surgit en plein cauchemar un monstre du nom de Boggs, il y a encore une place pour la Vie. Aller de l’avant grâce à nos fantômes et à nos morts. L’Espoir donc qui accompagne la traversée de l’adolescente.
Grace qui ne sait pas lire mais Grace qui apprend à lire la Vie.
Traduit par Marina Boraso.
Anne-Cé